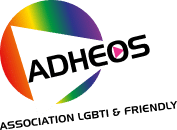Thulli Ncube, 31 ans, a été victime d’un «viol correctif» quand elle était adolescente. Pour TÊTUE, elle raconte l’impact de ce crime sur son parcours ainsi que sa vie de lesbienne à Soweto
«Après m’avoir violée, il m’a dit qu’il voulait me montrer que j’étais une femme». Thulli Ncube vit à Soweto, une immense banlieue de Johannesburg où résident environ 4 millions de personnes, noires et pauvres pour l’immense majorité. A 17 ans, alors qu’elle rentre de l’église, un individu cagoulé l’agresse et lui vole sa virginité. «Il m’a braqué un revolver sur la tête et a dit qu’il me tuerait si je ne me laissais pas faire. Il me demandait sans cesse pourquoi je voulais être un homme. Je sais qu’il me connaissait car il m’appelait par mon prénom.»
Arborant un look butch, chemise d’homme et crâne rasé, Thulli ne cachait pas son orientation sexuelle. «Ma petite amie venait souvent me voir jouer au football et on s’embrassait parfois en public. J’avais aussi dit à un groupe de copains que je n’étais pas attirée par les hommes».
«Jamais en sécurité»
Mais 14 ans plus tard, elle ne se sent «jamais vraiment en sécurité» et évite la compagnie des hommes. «Même ton meilleur ami peut se transformer en monstre. Les auteurs de «viols correctifs» sont presque toujours des gens qui connaissent la personne qu’ils agressent».
Comme une majorité de victimes (selon les associations, moins d’un viol sur dix serait déclaré), Thulli n’a pas porté plainte. «Cela ne servait à rien vu que je n’avais pas vu le visage de mon agresseur», dit-elle. «Et j’avais peur de la réaction de ma famille, de celle de la police… Je suis rentrée chez moi, j’ai pris un bain, et je n’ai rien dit à personne».
«S’il m’avait tuée»
C’était le 15 mai 1997. «Chaque année, au mois de mai, je me sens mal. Parfois je me dis que s’il m’avait tuée, je n’aurais pas la douleur que je dois porter aujourd’hui. J’ai aussi souvent pensé au suicide, mais je ne le fais pas pour ma fille».
Nobuhle est née il y a 8 ans (photo ci-contre). «Je voulais un enfant», raconte Thulli. «Une connaissance m’a proposé d’être le père si je couchais avec lui. Et j’ai accepté. Heureusement, je suis tombée enceinte du premier coup». Nobuhle ne sait pas que sa mère est homo, bien que celle-ci «pense qu’elle s’en doute».
Quitter le township
Dans beaucoup de familles, l’homosexualité reste un sujet tabou. En 2008, Thulli a fait son coming out auprès de sa mère et de sa grand-mère, avec qui elle vit. «Elles l’ont très mal pris. Pendant près d’un an, on ne se parlait plus», regrette-t-elle. «Aujourd’hui, elles commencent à accepter, mais je pense qu’elles espèrent toujours que je change et que je rencontre un homme».
La jeune femme, qui «voudrait un jour (se) marier», est célibataire et souffre de la solitude. «Je rencontre peu de nouvelles personnes car les bars homos sont dans les banlieues du nord de Johannesburg, et le transport coûte cher. A Soweto, je n’ose pas sortir. Alors je reste dans ma chambre à regarder la télé». A l’instar de la nouvelle classe moyenne noire, si elle avait le choix, elle quitterait certainement le township pour s’installer dans les maisons cossues des anciennes banlieues blanches. «Là où personne ne vous pose de question sur votre vie privée». Une option qui se heurte à la réalité financière.
«Après le viol, je n’arrivais plus à travailler à l’école. J’ai eu de mauvaises notes au bac et n’ai pas pu obtenir de bourse pour poursuivre mes études». Aujourd’hui, Thulli est sans emploi. «Ce n’est déjà pas facile de trouver du travail en Afrique du Sud, mais si vous êtes ouvertement lesbienne, les chances sont encore plus minces…»
Lire reportage sur les viols correctifs en Afrique du Sudici.