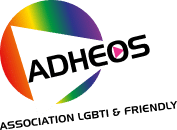ll ne prend jamais un taxi s’il ne connaît pas le chauffeur. Il est impensable pour lui de monter dans un bus. Il vit en dehors de Dakar, la capitale du Sénégal, dans un petit village où il se sent plus en sécurité. Pourtant, sa maison a déjà été incendiée. Parfois, il se fait agresser.
Il ne veut pas cacher qu’il est gay mais doit parfois fuir pour vivre à cause des menaces. Bien qu’il ne veuille pas garder l’anonymat, nous ne pouvons pas publier son nom par peur de mettre davantage sa vie en danger.
C’est la vie d’un homosexuel au Sénégal, où depuis 1966, tout homme ou femme pris en flagrant délit d’"acte d’homosexualité" ou d’"acte contre-nature" entre deux personnes de même sexe, risque jusqu’à cinq ans de prison.
Beaucoup d’homosexuels sont contraints de vivre dans le secret, craignant constamment d’être découverts, explique Sheba Akpokli, une militante des droits des LGBTQI+ d’Afrique occidentale, basée au Togo.
Elle décrit cette situation comme " l’obligation de se conformer, une insécurité constante, la peur d’être démasqué et la contrainte de toujours vérifier avant de se rendre quelque part."
Mais à quelques heures de vol, au large des côtes sénégalaises, les choses sont très différentes.
Dans la ville portuaire de Mindelo, sur l’île de Sao Vicente, au Cap-Vert, vit Tchinda Andrade, une femme transgenre âgée d’une trentaine d’années. Vêtue d’une robe colorée ou d’une jupe courte, elle vend ses beignets brésiliens (bolinhos en portugais) dans la rue, en plein jour. Personne ne l’insulte ou ne l’attaque. Elle n’a pas peur de finir en prison. Le Cap-Vert est classé comme le pays le plus tolérant envers les LGTBI+ sur le continent, selon le réseau de recherche Afrobaromètre.
"Voilà les tchindas!"
Dans les rues du Sénégal, les homosexuels se font ont insulter de "góor-jigéen", qui signifie littéralement “homme-femme” dans la langue locale, le wolof. Ce terme rabaisse spécifiquement leur masculinité.
Au Cap-Vert, les femmes transgenres sont étiquetées de "tchindas", en raison de la notoriété d’Andrade. Pourtant, ce terme argotique n’est pas péjoratif, mais plutôt une façon de reconnaître son rôle de pionnière.
"Tchinda a été la première à sortir du placard", affirme Rosa Dos Santos, une autre femme transgenre capverdienne. Quand elle marche dans les rues de Mindelo avec ses amis, les gens disent : "Voilà les tchindas".
Edinha Pitanga, une autre "tchinda", se souvient être restée assise devant la maison de Tchinda Andrade pendant des heures lorsqu’elle était adolescente.
"Que faites-vous assise ici toute seule ?", lui a demandé une fois Tchinda Andrade. Fascinée par cette dernière depuis son apparition au carnaval, Pitanga voulait simplement l’observer.
Andrade rappelle comment cet épisode a choqué et changé la société capverdienne.
Nous sommes dans les années 1990 et elle s’habille en femme depuis quelques années déjà. Arrive alors le carnaval annuel qui va la rendre célèbre. Alors que 90 femmes aux costumes colorés défilent dans les rues, elle enfile un haut de femme et les rejoints.
"Quand je suis arrivée dans la ville, tout le monde me regardait, même la police qui contrôlait le défilé du carnaval", se souvient-elle.
"Les gens applaudissaient et riaient."
Ce carnaval est entré dans l’histoire comme le "Tchindaval".
Dans des pays comme le Sénégal, les personnes LGTBI n’ont pas le sentiment d’être représentées.
"A l’école, elles sont taboues, les lois ne les défendent pas, les médias sont très homophobes, donc les gens pensent qu’il n’y a pas de personnes LGTBI dans leur pays", explique Marc Serena, coréalisateur du documentaire "Tchindas" en 2015.
Toute représentation des personnes homosexuelles est négative. Par exemple, dans de nombreux films réalisés à Nollywood, l’industrie cinématographique nigériane, les méchants sont montrés comme étant homosexuels.
C’est la raison pour laquelle la représentation est si importante. Et c’est ce que Tchinda Andrade et son “ Tchindaval " ont signifié pour la société capverdienne.
Se souvenant de son adolescence dans les années 1980 à Dakar, la capitale du Sénégal, Marame Kane, défenseur des droits des LGTBI aujourd’hui basé à Paris, explique qu’elle a été élevée dans une vision absolument binaire du monde : " Un couple, c’est un homme et une femme. On se marie et on a des enfants. On ne m’a jamais parlé de sexualité".
Dans le monde francophone des années 1980, "nous n’avions pas de modèle ni de représentation de ce qu’est une personne lesbienne, gay, bi ou trans", dit-elle.
Cela n’a changé qu’en 2004, lorsque la chaîne française Canal+ a commencé à diffuser la série américaine The L World, sur un groupe d’amies lesbiennes.
"Cette série a façonné ma vie d’adulte", dit Kane.
De retour à Mindelo, Pitanga se souvient de son coming out. A l’âge de 12 ou 13 ans, elle s’est habillée en femme pour la première fois, sachant qu’elle avait des prédécesseurs qui lui avaient déjà ouvert la voie : Tchinda, Betina, Anita, Badia…
L’exception africaine
Il y a dix ans, Marc Serena a traversé 17 pays africains pour recueillir des témoignages de la communauté LGTBI africaine pour son livre "¡Esto no es africano!", publié à l’origine en espagnol.
Il dit que ce qu’il a vu à Mindelo était très différent des rues du Sénégal, le territoire continental le plus proche.
"Il est très difficile de voir des filles transgenres marcher dans la rue à Dakar ; elles n’ont pas le droit d’être visibles", dit-il.
"Beaucoup de Sénégalais m’ont dit que lorsqu’ils vont au Cap-Vert et qu’ils voient Tchinda et ses amis, ils se mettent à prier au milieu de la rue pour contrebalancer ce que leurs yeux voient. Cela peut être un grand choc pour les Sénégalais."
En Afrique subsaharienne, plus de la moitié des pays ont des lois interdisant ou réprimant l’homosexualité.
"Ce que nous voyons en Afrique est quelque chose dont l’Europe s’est complètement débarrassée en 2014, lorsque Chypre du Nord est devenue sa dernière région à dépénaliser les actes sexuels consensuels entre personnes de même sexe", explique Lucas Ramón Mendos, chercheur et auteur du rapport State-Sponsored Homophobia de l’International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association, basé à Genève.
Mais au Cap-Vert, l’homosexualité n’est ni illégale ni punissable. Sur l’archipel, la lutte pour les droits des LGTBI a même atteint un autre niveau puisque les militants cherchent à légaliser les unions entre personnes de même sexe.
Pourquoi ce pays africain est-il devenu une exception sur le continent ?
Serena évoque des facteurs tels que l’isolement naturel du Cap-Vert dans l’océan Atlantique. Il s’agit d’une petite communauté où tout le monde se connaît depuis l’enfance.
Ensemble, les "tchindas" de Mindelo sont devenus une communauté forte qui se protège mutuellement. "Ils ont réussi à pirater le carnaval, le festival le plus important du pays qui dure des mois, et pas seulement des jours", explique Serena.
Andrade et ses amis ont gagné un droit qui serait impensable au Sénégal : celui de défiler ouvertement devant leurs voisins, sans crainte de représailles.
Mais l’apparente liberté du carnaval est trompeuse, dit Serena.
Le reste de l’année, les "tchindas" ont du mal à trouver du travail et de l’amour. En portant une robe et des talons hauts, Andrade ne peut travailler que comme vendeuse de rue.
"Il y a encore beaucoup de préjugés", dit-elle.
Elle est tombée amoureuse à plusieurs reprises, mais ses petits amis ne veulent jamais sortir avec elle en plein jour. Le tabou est toujours là.
Pitanga ne trouve pas non plus facilement un emploi et elle souhaite épouser son petit ami, mais cela reste illégal dans le pays le plus tolérant en matière de LGBTI en Afrique.
Main dans la main avec les droits de la femme
Au-delà des spécificités culturelles de Tchinda Andrade, du carnaval et de la petite communauté insulaire soudée, la tolérance des LGTBI au Cap-Vert peut être liée à sa forte égalité entre les sexes.
Cela est dû au leader anticolonialiste Amílcar Cabral (1924-1973), explique Claudia Rodrigues, sociologue et ancienne présidente de l’Institut cap-verdien pour l’égalité et l’équité entre les sexes.
Chaque fois que Cabral a libéré un territoire et établi un nouveau gouvernement local, il a attribué un certain nombre de rôles importants aux femmes.
"S’il y avait trois personnes dans le gouvernement : au moins une femme ; s’il y en avait cinq : au moins deux femmes", dit Rodrigues.
Après que l’ancienne colonie portugaise est devenue un pays indépendant en 1975, les féministes capverdiennes ont fait pression pour l’égalité des femmes et l’impact de cette action est encore visible aujourd’hui.
Le rapport 2020 du Forum sur la politique de l’enfance en Afrique (ACPF) classe le Cap-Vert parmi les pays les plus "favorables aux femmes".
L’avortement a été légalisé en 1987 et les mutilations génitales féminines sont interdites.
"Ce mouvement en faveur des droits de la femme et des droits de l’Homme nous a aidé à être plus ouverts à une culture de non-discrimination", déclare M. Rodrigues.
La lutte des femmes a également servi aux femmes transgenres, ajoute Serena.
Le colonialisme et le "vrai homme africain".
Plusieurs chercheurs associent l’homophobie à un rejet culturel des traits considérés comme féminins.
C’est la raison pour laquelle les Sénégalais insultent les homosexuels en les appelant "góor-jigéen" ou homme-femme. Le but est de blesser profondément leur virilité.
"Ces dernières décennies, la masculinité au Sénégal a évolué de telle manière que tout signe de féminité est devenu dangereux, menaçant pour l’identité masculine", explique Cristophe Broqua, socio-anthropologue au Centre national français de la recherche scientifique.
L’idée que les hommes africains doivent être hyper-masculins et dominants n’a pris racine qu’à l’époque coloniale, sous les Portugais et les Français, explique l’anthropologue sénégalais Cheikh Niang.
Il fait le lien avec l’opposition farouche des reines du royaume historique du Waalo, qui fait aujourd’hui partie du Sénégal et de la Mauritanie moderne, aux colons européens. Les Sénégalais avaient autrefois une approche plus souple de la question du genre, comme en témoigne la langue locale wolof, parlée par 80 % de la population.
Dans cette langue, le concept de personne englobe à la fois des éléments masculins et féminins, explique Niang.
"Nous reconnaissons qu’un homme a un côté féminin", dit-il, en citant des qualités telles que l’empathie et la compassion.
Les puissances coloniales "ont introduit la pénalisation ou, en tout cas, une sorte d’attitude de plus en plus dure à l’égard de l’homosexualité" et de "toute la diversité", explique Mohamed Mbougar Sarr, romancier sénégalais primé.
"Nous devons réaliser que cela faisait aussi partie des nombreuses choses que le colonialisme a détruites".
Malgré cela, de nombreux Africains affirment que l’homosexualité ne fait pas partie de la culture locale mais a été "importée". Les politiciens de la région s’en servent comme d’un outil politique pour attaquer l’Occident.
"Les lois de notre pays obéissent à des normes qui sont un condensé de nos valeurs de culture et de civilisation", a déclaré le président sénégalais Macky Sall au Premier ministre canadien Justin Trudeau, lors d’une conférence de presse conjointe en février 2020 au Sénégal, lorsque ce dernier lui a demandé quand il comptait dépénaliser l’homosexualité.
Cependant, les historiens ont documenté des pratiques sexuelles entre personnes de même sexe dans de nombreuses cultures africaines avant l’arrivée des Européens. Ces pratiques n’étaient pas considérées avec dégoût et étaient complètement normalisées.
Dans un article intitulé "The Invention of Homophobia”, Boris Bertolt, doctorant à l’université du Kent, dans le sud-est de l’Angleterre, donne plusieurs exemples :
Au Cameroun, les femmes ont organisé un rituel célébrant le clitoris et le pouvoir féminin, avec des danses mimant le coït et des femmes post ménopausées jouant le rôle masculin, écrit-il.
Dans les régions de la forêt tropicale d’Afrique centrale, les Pahuin toléraient socialement les relations homosexuelles entre hommes, bien qu’ils aient des épouses.
Les Fangs, une autre ethnie d’Afrique centrale, considérait les relations homosexuelles comme un moyen de transmettre la richesse "du partenaire réceptif (le pédicier) au partenaire insertif (le pédicon)", écrit Bertolt.
Ce sont là quelques-uns des nombreux exemples antérieurs à l’ère coloniale et à l’avènement du concept occidental d’homosexualité : "un terme initialement introduit en Occident pour contrôler les relations sociales, tout en étiquetant les personnes engagées dans des relations homosexuelles comme déviantes", écrit Bertolt.
Et il ne s’agissait pas seulement d’étiquettes, mais aussi de lois interdisant le sexe homosexuel.
"Dans les lois coloniales, vous avez toutes ces dispositions homophobes", dit Niang.
"Nous avons simplement copié et collé. Nous avons étendu des lois qui existaient sous le colonialisme."
L’impérialisme LGTBI : une nouvelle forme de colonialisme sexuel
Broqua met en garde contre la montée d’un nouveau type de "colonialisme sexuel", lorsque l’Occident dicte les catégories LGTBI et ignore toute diversité sexuelle qui ne s’y inscrit pas.
"Partout dans le monde, nous avons assisté à un phénomène d’homogénéisation", dit Broqua.
"Il y a encore une très forte imposition" des concepts occidentaux de la sexualité, dit-il, "particulièrement à travers des choses qui sont censées être bénéfiques (et) bienveillantes, comme la lutte contre le sida".
Cela "a une forte influence sur l’évolution des catégories identitaires au niveau local".
Serena souligne également l’importance de "ne pas coloniser à nouveau avec nos mots et nos cadres mentaux" et la nécessité de "travailler de pair-à-pair".
Il évoque ses propres découvertes qui ont démenti ses idées préconçues sur la façon dont les personnes LGBTI vivent en Afrique.
"J’ai été surpris de constater que les gens sont capables de créer leurs bulles – leur environnement de sécurité, leur famille non biologique – qui les aident à survivre", dit-il.
Il a également constaté que son idée selon laquelle "il y a plus de pression (sur les personnes LGTBI) dans les zones rurales était une idée fausse". Au contraire, il a remarqué que ces personnes y étaient plus libres.
Serena a également été frappée par l’existence du mariage entre femmes.
En Tanzanie, par exemple, les femmes Kuira sont autorisées à former des unions homosexuelles selon la tradition du nyumba ntobhu, ou "maison des femmes".
Il pense que le mouvement LGTBI en Europe est très déconnecté de ces réalités et se concentre trop étroitement sur sa zone de confort.
"C’est beau de comprendre que nous pouvons aussi apprendre de l’Afrique, notamment à travers l’exemple du Cap-Vert", dit-il, tout en soulignant la nécessité de ne pas idéaliser ou prétendre que la vie là-bas est "Tchindaval” toute l’année.
"Tchinda (Andrade) l’a gagné de manière très individuelle, souvent de ses propres mains, avec violence", dit-il.
"C’est une toute petite île. Elle a une très forte personnalité et a revendiqué son espace, rue par rue."
Et il ajoute : "Le mouvement LGTBI est parfois très théorique, mais ces femmes ont entrepris un combat très proche du quartier, et très passionné."
Traduit par Peya Mame Diaw, édité par Raphaële Tavernier et Anna Malpas ; avec la contribution de Marta Moreiras et Arwa Barkallah au Sénégal et de Lillo Montalto Monella et Naira Davlashyan en France. Les témoignages du Cap-Vert inclus dans cette pièce proviennent du documentaire Tchindas (Pablo García Pérez de Lara et Marc Serena, 2015). Pour le découvrir dans son intégralité et accéder à des contenus supplémentaires : http://www.tchindas.com/
- SOURCE EURONEWS