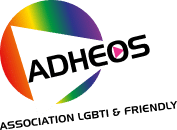Alors que les combats pour les droits LGBT sont loin d’être gagnés, la disparition de «Yagg», fondé par des anciens de «Têtu», illustre les difficultés de la presse communautaire, touchée par la baisse des revenus publicitaire et un lectorat infidèle.
Yagg, «média unique en son genre», n’est plus. Mercredi, via un communiqué, la rédaction du site d’information lesbien, gay, bi et trans a annoncé que le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation judiciaire de LGNET, la société éditrice de ce journal en ligne fondé en 2008 par quatre anciens du magazine gay Têtu, Judith Silberfeld, Xavier Héraud, Christophe Martet et Yannick Barbe.
C’est incontestablement un coup dur pour les cinq salariés de Yagg, qui perdent ainsi leur emploi, pour la presse en général, qui perd de nouveau un titre indépendant, mais également pour la presse communautaire LGBT, qui perd l’un de ses derniers titres en France. Faut-il rappeler qu’il y a un peu plus d’un an, le 23 juillet 2015, le mensuel Têtu disparaissait des kiosques, quelques jours après avoir soufflé ses vingt bougies, plombé par le recul de ses ventes et ses dettes ? Depuis, le journal a été racheté et survit en ligne, malgré la volonté de ses propriétaires de relancer une version imprimée l’an prochain, selon nos informations.
«En ce moment, c’est dur pour toute la presse. Pour la presse LGBT, des journaux indépendants isolés dans leur coin, ça l’est encore plus, lâche Xavier Héraud, rédacteur en chef de Yagg depuis le printemps. On s’est lancé en même temps que Mediapart et Rue89 et on a essayé d’accompagner cette transformation du paysage de l’information. Au final, on a manqué ce tournant parce qu’on pensait que la pub allait se maintenir.» Et le modèle payant, mis en œuvre depuis juin n’a pas compensé.
En tout et pour tout, l’aventure Yagg aura donc duré huit ans et celle de Têtu, vingt. Une longévité rare pour un journal communautaire homo en France dont la durée de vie, comme feu Gai Pied Hebdo (1979-1992), est plutôt de l’ordre d’une dizaine d’années. A titre de comparaison, aux Etats-Unis, le plus vieux magazine gay, The Advocate, fondé à Los Angeles en 1967, tire encore des centaines de milliers d’exemplaires ; au Québec, le mensuel Fugues a fêté ses 30 ans en présence du maire de Montréal ; et au Royaume-Uni, Attitude, imprimé depuis 1994, poursuit tranquillement sa route.
Faut-il y voir l’œuvre d’une «malédiction» française ? «Les médias homos français sont comme accablés par une sorte de fatalité. Ça dure quelques années et puis ça se casse la gueule pour des raisons financières contrairement aux médias généralistes qui, pour certains, existent depuis des décennies. C’est peut-être un problème de culture politique républicaine qui honnit les communautés, ou alors de marché», regrette Romain Vallet, rédacteur en chef d’Hétéroclite, un mensuel distribué gratuitement à 20 000 exemplaires à Lyon, Grenoble et Saint-Etienne. Pour tenir l’équilibre, sa publication queer «mais pas que» a donc adopté un modèle économique «frugal et frustrant» : un salarié et demi, des pigistes, des salaires modestes, soit «une économie de bouts de ficelle», qui pour l’instant s’est révélée payante.
Investisseurs frileux
Pour s’en sortir et relancer la machine, les fondateurs de Yagg espéraient, eux, trouver un repreneur en capacité d’investir dès cette année. En vain. «Aujourd’hui qui veut investir dans la presse communautaire ? On a vraiment eu du mal à trouver des investisseurs potentiels, déplore aujourd’hui Xavier Héraud. La presse tout court, et encore moins LGBT, ça ne fait pas rêver.» La frilosité des investisseurs n’explique pas tout. En quelques années, les revenus issus de la publicité, et notamment de la lutte contre le VIH, se sont taris. «C’est pourtant eux qui ont permis en partie l’essor d’une presse gay, et non d’une presse lesbienne», explique Charles Roncier, rédacteur en chef adjoint du site d’information VIH.org.
«A Têtu, on n’avait pas de problèmes de trésorerie dans les grandes années, se souvient pour sa part Thomas Doustaly, à la tête de la rédaction de 1998 à 2008. A partir du moment où on a dépassé les 50 000 lecteurs certifiés OJD, les annonceurs nous ont même regardés différemment. Après 2008 le magazine est repassé en dessous de ce seuil et il est ressorti des plans médias. Le socle pour un journal, c’est d’être lu par sa communauté.» D’autant qu’aujourd’hui, de plus en plus de sites généralistes, la plupart d’origine américaine – Slate, Buzzfeed, le Huffington Post – suivent l’actualité LGBT avec plus d’assiduité.
Face à ses obstacles, en 2014, l’équipe de Well Well Well, revue lesbienne irrégulièrement semestrielle, a donc opté, comme ses aînées de Lesbia (1982-2012), pour le bénévolat. «Le public de la presse LGBT est restreint et les annonceurs boudent nos médias pour leur image de marque, avance Marie Kirschen, sa rédactrice en chef. La conséquence de ce choix, c’est qu’on fonctionne avec un budget ridicule, environ 10 000 euros par numéro en impression.»
«Nouvelles attentes du lectorat»
Stéphanie Delon, directrice de publication de Jeanne Magazine (un mensuel en ligne lesbien lancé en janvier 2014) partage la même conviction. En 2013, après dix ans d’activité, elle a assisté impuissante à la liquidation judiciaire de Muse&Out (Ex-la Dixième Muse), un magazine lesbien porté par le renouveau de la culture lesbienne et le boom des séries comme The L Word dans les années 2000. «Le lectorat LGBT a l’impression qu’à chaque fois qu’un média LGBT disparaît un autre va renaître. Or, ce n’est pas un dû, il y a des salariés derrière. Le jour où cette volonté disparaîtra, il n’y a aura plus de médias communautaires et on aura plus que quelques articles dans la presse généraliste», poursuit Stéphanie Delon.
Depuis l’après-guerre et la revue «homophile» Arcadie (1954-1982) distribuée par abonnement en toute discrétion, la presse homosexuelle a d’ailleurs toujours dû faire face à des enjeux propres comme la taille de son lectorat, son positionnement identitaire et la fragilité de son modèle économique. «Pour les revues militantes, la possibilité d’exister s’est toujours posée moins pour des raisons économiques que faute de synergies associatives», assure Massimo Prearo, post-doctorant à l’université de Vérone, qui a étudié le mouvement homosexuel à travers ses publications militantes (1). Il ajoute : «Le problème est plutôt du côté du projet éditorial, qui doit pouvoir survivre aux différents contextes politiques et militants. Aujourd’hui, le contenu politique des médias communautaires a pu poser problème en France en raison de nouvelles attentes et affiliations du lectorat LGBT après l’adoption de la loi sur le mariage pour tous.»
Catherine Gonnard, rédactrice en chef de Lesbia de 1989 à 1998, partage la même interrogation : «On est une presse d’accompagnement. Dès que le lectorat sort de son interrogation identitaire, qu’a-t-on à lui dire ?» «Face à la gauche qui a dégoûté tellement de gens, j’aurais donné une vision plus combative, pas middle of the road. On verra si la nature a horreur du vide et si quelque chose se crée après la présidentielle», défend de son côté Didier Lestrade, fondateur de Têtu en 1995. Pourtant, les combats pour les droits sont loin d’être gagnés, et le travail d’information toujours nécessaire.
- SOURCE LIBERATION